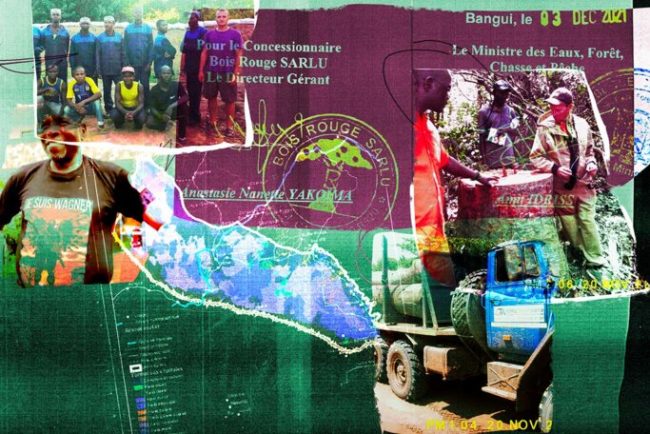Jeudi 14 août 2025 restera gravé dans la mémoire de la commune de Ndjim, dans le nord-ouest de la Centrafrique. Luc Belpki, maire de Ngaoundaye, et neuf autres personnes ont été interceptés et agressés par des éléments du groupe armé 3R sur l’axe Paoua. Le maire, en route pour une réunion sur la transhumance apaisée, a été hospitalisé en soins intensifs. Son état inspire une inquiétude profonde. Quant aux autres victimes, leur sort demeure incertain.
Cet événement tragique intervient alors qu’un accord de paix récent avait été signé entre le gouvernement centrafricain et certains groupes armés, dont les 3R. Ces accords, porteurs de promesses de retour à la sécurité et à la stabilité, semblent aujourd’hui mis en échec par des actes de violence qui questionnent la crédibilité même des engagements pris par les belligérants. La question est désormais sur toutes les lèvres : peut-on encore parler de paix dans un pays où certains groupes armés continuent de semer la terreur sans aucune sanction ?
L’attaque de Ndjim met en lumière une problématique inquiétante : l’absence apparente de protection effective pour les populations. Les forces nationales et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) sont censées assurer la sécurité des citoyens et garantir le respect des accords de paix. Pourtant, les faits du jeudi 14 août suggèrent une incapacité à répondre à cette obligation.
Cette défaillance crée un sentiment d’abandon chez les populations locales, exposées à la violence et à l’arbitraire. Alors que le pays s’approche d’élections cruciales, la sécurité des acteurs politiques, des civils et des représentants de l’administration devient un enjeu central. La non-intervention des forces de sécurité pourrait avoir des conséquences lourdes, en sapant la confiance des citoyens envers les institutions et en compromettant la légitimité du processus électoral à venir.
Des paroles trahies par les actes
Lors de la signature des accords de paix, le président Faustin-Archange Touadéra et les leaders des groupes armés avaient échangé des paroles empreintes de solennité. Retour à la paix, sécurité, confiance mutuelle : autant de mots forts qui, sur le papier, devaient marquer le début d’une ère nouvelle pour la Centrafrique.
Or, la réalité sur le terrain semble trahir ces engagements. L’attaque de Ndjim n’est pas un incident isolé ; elle s’inscrit dans une série d’agressions qui démontrent l’impunité dont jouissent certains groupes armés. La dissonance entre la parole officielle et les actes effectifs fragilise non seulement la crédibilité des accords, mais aussi celle du gouvernement et des institutions internationales impliquées dans le processus de réconciliation.
L’événement du 14 août soulève également des interrogations stratégiques. S’agit-il d’une simple provocation, destinée à tester la réaction des autorités ? D’une humiliation publique, visant à démontrer le contrôle des zones rurales par les groupes armés et à ridiculiser les institutions centrales ? Ou bien le début d’un bras de fer ouvert, annonciateur d’une nouvelle escalade ?
Quel que soit le motif, il est clair que la Centrafrique ne peut se permettre d’adopter une posture passive. L’avenir du pays et la crédibilité des prochains scrutins dépendent de la capacité des autorités à répondre avec fermeté et transparence. L’inaction pourrait être interprétée comme une acceptation implicite de l’impunité, renforçant ainsi l’audace des groupes armés.
Recommandations pour restaurer la confiance et la sécurité
Pour que le pays puisse véritablement s’acheminer vers un climat de paix, plusieurs mesures s’imposent. Ces recommandations sont à la fois urgentes et stratégiques, et leur mise en œuvre conditionnera le déroulement serein des élections.
Un déploiement rapide et effectif des forces nationales et de la Minusca est nécessaire dans les zones à risque, en particulier dans le nord-ouest. La sécurisation des axes routiers, des communes et des points stratégiques doit devenir une priorité absolue. Sans protection concrète, les citoyens restent exposés à la violence et à l’instabilité.
La justice doit agir avec impartialité et transparence. Toutes les agressions, qu’elles soient commises par des individus ou des groupes armés, doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires. La mise en lumière de ces responsabilités est essentielle pour restaurer la confiance des populations dans les institutions étatiques.
Tout manquement ou violation doit être signalé publiquement et corrigé immédiatement. La transparence dans le suivi des accords est indispensable pour montrer que les engagements sont contraignants et sérieux. Il ne peut y avoir de paix durable si les acteurs impliqués peuvent ignorer leurs obligations sans conséquence.
Avec les élections approchant, il est impératif de sécuriser les mairies, les lieux de rassemblement et les routes empruntées par les responsables politiques et les citoyens. Un climat apaisé est la condition sine qua non pour permettre la tenue d’un scrutin libre et crédible.
La Centrafrique se trouve à un carrefour décisif. La signature des accords de paix a suscité un espoir légitime parmi les populations. Cependant, les attaques récentes, comme celle de Ndjim, démontrent que ces espoirs peuvent rapidement se transformer en désillusion si la sécurité et la justice ne sont pas garanties.
La responsabilité des autorités est immense. Elles doivent montrer que les paroles ne suffisent pas et que la violence ne restera pas impunie. La mise en œuvre rigoureuse des recommandations précédentes est essentielle pour que le pays aborde les élections dans un climat de paix réelle. La sécurité, la transparence et la justice ne sont pas des luxes : elles constituent la condition nécessaire pour que les Centrafricains puissent voter en toute confiance et vivre dans un environnement protégé.