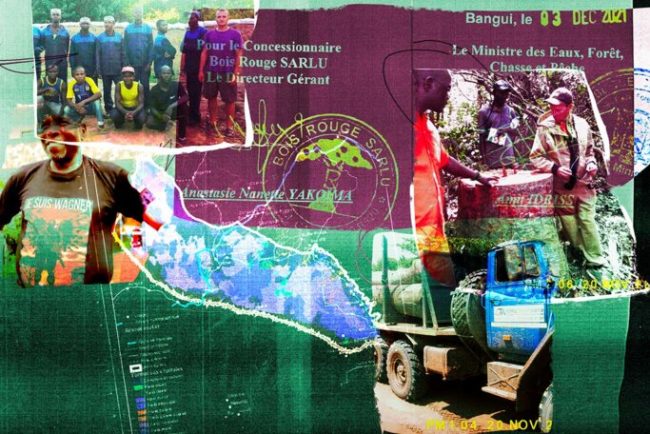L’échiquier géopolitique du Moyen-Orient vient de basculer une fois de plus dans l’incertitude. En 2018, l’administration Trump, sous l’influence probable de partenaires stratégiques comme l’Arabie saoudite, avait décidé de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien (JCPOA). Une rupture brutale, qui a mis fin à des années de diplomatie multilatérale et ravivé les tensions entre l’Iran et l’Occident.
Six ans plus tard, à la date symbolique marquant l’expiration de l’ultimatum de 60 jours imposé par Washington depuis le retour de Trump à la maison blanche, l’Iran fait face à une offensive militaire israélienne, qualifiée de préventive. Fait troublant : Donald Trump, figure centrale de cette politique étrangère dure, déclare avoir été informé à l’avance de cette frappe, laissant planer le doute sur une coordination tacite entre Tel-Aviv et certaines sphères américaines.
Ce scénario relance le débat sur l’échec d’une solution diplomatique durable. Alors que les tensions régionales s’enracinent, et que les blocs internationaux se recomposent autour de nouveaux axes d’influence, tout porte à croire que la relance d’un dialogue autour du nucléaire iranien est désormais hors de portée, emportée par les logiques de confrontation et d’alliances stratégiques rigides.
L’espoir d’un équilibre par la négociation semble céder la place à une nouvelle ère d’hostilité froide, où le droit international peine à contenir la montée des tensions militaires. Une évolution qui interroge non seulement sur l’avenir du Moyen-Orient, mais aussi sur la capacité des grandes puissances à privilégier le dialogue par rapport à sur la démonstration de force.
Proche-Orient en feu : quelles répercussions pour l’Afrique ?
Depuis vendredi 13 juin, une nouvelle escalade militaire entre Israël et l’Iran bouleverse l’équilibre régional. Les frappes croisées ont déjà fait plus de 220 morts côté iranien et 24 côté israélien. Mais à des milliers de kilomètres de là, en Afrique, cette confrontation provoque des secousses diplomatiques, économiques et sécuritaires inattendues.
Alors que Tel-Aviv a visé plusieurs installations nucléaires et militaires stratégiques en Iran, provoquant une riposte iranienne sans précédent contre Tel-Aviv et Jérusalem, les chancelleries africaines observent avec inquiétude la tournure du conflit.
« L’Afrique ne peut plus se permettre la neutralité silencieuse », estime Benjamin Augé, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (IFRI). « Les partenariats de défense, les échanges énergétiques et les investissements directs étrangers sont désormais profondément influencés par les positionnements vis-à-vis de Tel-Aviv ou Téhéran. »
Plusieurs pays du Sahel, comme le Mali, le Niger ou encore le Tchad, entretiennent des liens militaires renforcés avec l’Iran depuis le retrait progressif des forces occidentales. À l’inverse, le Rwanda, le Kenya et le Maroc bénéficient de coopérations stratégiques actives avec Israël dans les domaines de la cybersécurité, de l’agriculture et du renseignement.
Le choc pétrolier menace les économies africaines
Même si le détroit d’Ormuz zone sensible du Golfe persique par où transite près de 20 % du pétrole mondial n’a pas encore été directement visé, la flambée des prix du baril, passé de 85 à 113 dollars en trois jours, impacte déjà lourdement les pays importateurs comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, ou la RDC.
« Les subventions aux carburants explosent alors même que nos finances publiques sont fragilisées par le service de la dette », confie un haut fonctionnaire ivoirien sous couvert d’anonymat. Les hausses des prix du transport, des intrants agricoles et de l’électricité risquent d’entraîner une nouvelle poussée inflationniste dans les pays les plus vulnérables.
Autre inquiétude : la récupération idéologique du conflit par certains groupes extrémistes présents en Afrique de l’Ouest. L’EIGS (État islamique au Grand Sahara) ou le JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), bien que concentrés sur des objectifs locaux, pourraient exploiter cette guerre religio-politique comme un argument de mobilisation.
« Les dynamiques d’allégeance peuvent être ravivées par des affrontements qui prennent une tournure eschatologique ou symbolique. La rhétorique anti-sioniste, par exemple, est un marqueur que certains groupes jihadistes exploitent dans leur propagande », explique Benjamin Augé.
Face à cette crise, l’Union africaine (UA) peine à parler d’une seule voix. Si le président comorien Azali Assoumani, président en exercice de l’UA, a appelé à « la retenue et au dialogue », aucune résolution ferme n’a été proposée, laissant apparaître des lignes de fracture diplomatiques profondes entre les États membres.
« L’Afrique est aujourd’hui un terrain de projection secondaire de la rivalité irano-israélienne. Ce conflit pourrait accélérer les alignements idéologiques et militaires sur le continent, au détriment de la stabilité régionale », conclut Augé.
Alors que les sirènes retentissent à Tel-Aviv et que Téhéran promet des représailles durables, l’Afrique regarde vers le Proche-Orient avec crainte. Non pas tant pour la géographie du conflit, que pour ses ondes de choc invisibles mais redoutablement puissantes.