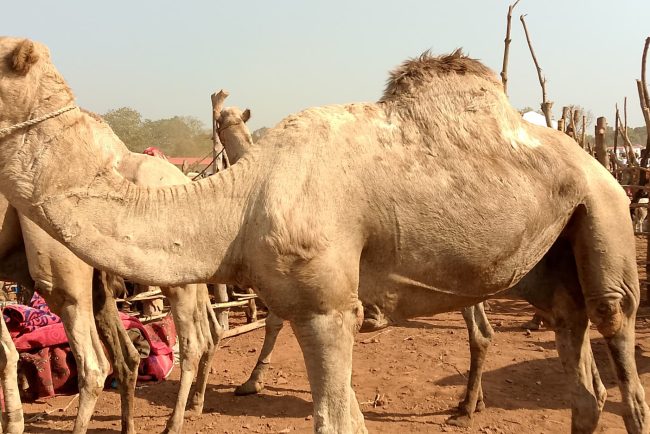Sous les applaudissements nourris, les discours vibrants et les banderoles de circonstance, la cérémonie de remise d’attestations de fin de formation aux enseignants du préscolaire et du Fondamental 1, tenue récemment au Lycée Scientifique Faustin-Archange Touadéra, s’est déroulée avec tout le faste que peut se permettre un État en quête de symboles. Pourtant, derrière cette vitrine officielle, les fondations du système éducatif centrafricain demeurent précaires, instables, et profondément inégalitaires.
Le ministre de l’éducation, dans un ton solennel, n’a pas manqué de souligner l’importance de cette étape dans la mise en œuvre du Plan Sectoriel de l’Éducation 2020 2029. « Vous êtes les acteurs du changement. Vous incarnez l’avenir de notre école », a-t-il déclaré devant une assemblée visiblement émue. Ce plan, financé en partie par les Partenaires Techniques et Financiers, ambitionne de former 10 000 enseignants sur cinq ans, avec pour objectif de combler un déficit structurel qui plombe l’éducation nationale depuis des décennies. Sur le papier, la démarche est salutaire. Elle répond à un besoin urgent : celui de remplacer progressivement les maîtres-parents, souvent sans qualification, par des enseignants formés selon les normes pédagogiques nationales. Mais comme souvent en Centrafrique, entre la volonté affichée et la mise en œuvre effective, le gouffre reste béant. La formation dispensée à Bangui, notamment au Centre Pédagogique Régional (CPR), est souvent mise en avant comme un modèle de réussite. Doté d’un encadrement plus structuré et de quelques moyens logistiques, ce centre bénéficie d’une attention parti culière du ministère. Cependant, la situation dans les provinces contraste brutalement avec cette image relui sante. Dans les régions reculées de la Nana Mambéré, de l’Ouham-Pendé ou de la Haute-Kotto, les centres de formation sont rudimentaires, parfois inexistants. Les stagiaires doivent composer avec des salles vétustes, un manque chronique de matériel pédagogique, et une absence quasi totale de suivi. La dispa fracture éducative qui s’ajoute à celles déjà causées par la pauvreté et l’insécurité. Un système à la dérive malgré les ambitions La cérémonie de remise des attestations, bien orchestrée, aurait pu être le reflet d’un tournant décisif. Elle apparaît plutôt comme un moment de communication politique, à quelques mois des élections générales. Car dans les faits, les problèmes qui minent l’école centrafricaine restent entiers. Dans les zones rurales, les maîtres parents continuent d’assurer l’enseignement de base, souvent sans aucune formation ni accompagnement. Les écoles manquent de tout : manuels scolaires à jour, craie, mobilier, infrastructures sanitaires. Dans certaines localités, les élèves s’entassent à plus de 100 par classe, parfois à même le sol. À cela s’ajoute une situation sociale explosive : les enseignants régulièrement formés sont mal rémunérés, leur salaire versé en retard ou suspendu sans explication. La précarité du métier, conjuguée à une absence de perspectives de carrière, explique l’exode de nombreux professionnels vers d’autres secteurs ou vers l’étranger. Comment « inventer » et « s’adapter au monde qui change », comme l’a exhorté le ministre, quand l’enseignant lui-même ne parvient pas à vivre décemment de sa fonction ? Officiellement, l’État affirme vouloir faire de l’éducation une priorité nationale. Pourtant, dans les faits, les budgets alloués restent dérisoires par rapport aux besoins. Les promesses d’investissements structurels se heurtent à une réalité budgétaire contrainte, à une gouvernance souvent défaillante, et à une dépendance persistante vis-à-vis des partenaires extérieurs. Le paradoxe est cruel : pendant que l’on célèbre l’arrivée de nouvelles pro motions d’enseignants, les conditions qui leur permettraient d’exercer efficacement ne sont pas réunies. Sans équipement, sans inspection pédagogique régulière, sans soutien psychologique ou professionnel, l’enseignant centrafricain est laissé à lui-même, dans un système qui peine à reconnaître son rôle fondamental. Une réforme de fond, pas seulement de façade Si la formation de nouveaux enseignants constitue un levier de transformation incontournable, elle ne saurait suffire à elle seule à relever le système éducatif. Il ne s’agit pas seulement d’accroître les effectifs, mais d’accompagner, de valoriser, de sécuriser ces professionnels du savoir. Sans une politique éducative globale, cohérente et équitable, les cérémonies comme celle du Lycée Faustin-Archange Touadéra ne seront que des écrans de fumée. Il est urgent que l’État centrafricain cesse de faire de l’éducation un outil de propagande politique et la considère enfin comme ce qu’elle est : la condition sine qua non du développement national. Investir dans l’école, ce n’est pas investir dans un slogan de campagne, c’est construire les bases solides d’une nation souveraine, instruite, et capable de relever les défis du XXIe siècle.
Roméo Silvère Doubalet