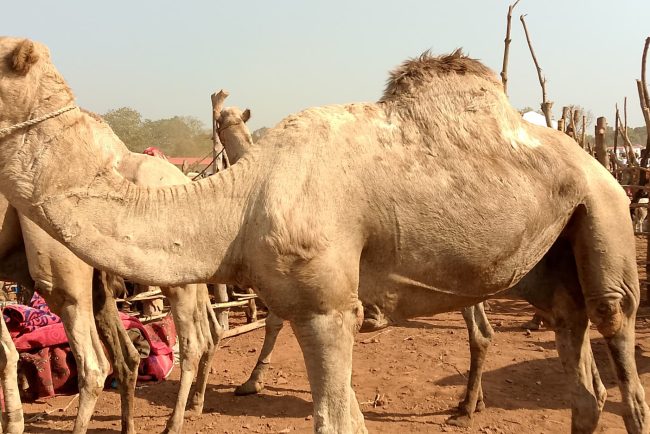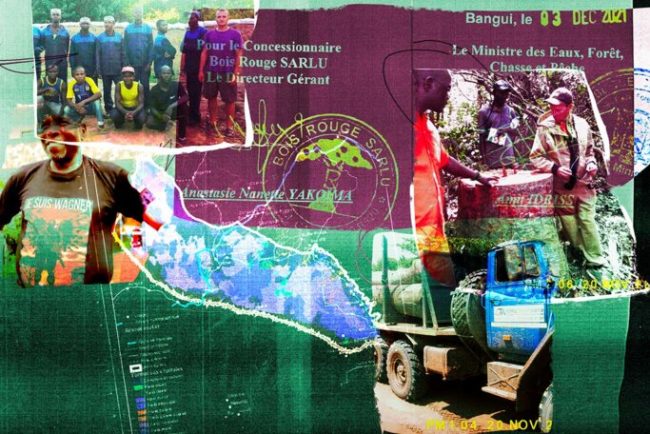Lors d’une conférence de presse à Bangui tenue au courant de la semaine écoulée, le Président de l’Autorité Nationale des Élections (ANE), Dr Mathias Barthélemy Morouba, a dressé un bilan optimiste de l’opération d’affichage des listes électorales provisoires.
Derrière le ton rassurant et les chiffres en apparence solides, des interrogations demeurent sur la transparence réelle du processus électoral, l’indépendance de l’institution, et la capacité du pays à organiser des élections crédibles en décembre.
Selon le président de l’ANE, le fichier électoral provisoire consolidé compterait 2 383 992 électeurs valides, dont 749 889 nouveaux enrôlés en 2025, représentant près d’un tiers du corps électoral. Il affirme également que 750 000 électeurs ont consulté les listes, soit environ 31 % de participation à l’affichage.
Mais ces chiffres, aussi précis soient-ils, soulèvent plusieurs questions :
1. Comment garantir l’authenticité des nouveaux enrôlements dans un pays où l’État peine à exercer son autorité sur plus de 40 % du territoire ? L’ANE évoque des « équipes mobiles » déployées dans les zones reculées, sans fournir d’éléments tangibles sur leur méthodologie, les vérifications effectuées, ou les risques de doublons.
2. Qu’en est-il du contrôle citoyen ? Le discours mentionne des « fiches de réclamation » et des « lignes téléphoniques dédiées », mais aucune statistique n’a été donnée sur le nombre exact de réclamations, leur nature précise, ni sur les délais de traitement. Cette absence de données vérifiables laisse un flou inquiétant.
3. Pourquoi l’ANE reste-t-elle évasive sur la cartographie sécuritaire des centres non fonctionnels ? Le président parle d’un taux de fonctionnalité de « 87 % des centres », mais ne précise pas où se trouvent les 13 % restants : est-ce dans l’Ouham-Pendé, la Vakaga, la Bamingui-Bangoran, ou dans les zones sous occupation armée ?
Le président Morouba a réagi aux critiques exprimées sur les réseaux sociaux, en dénonçant des propos « empreints de mépris » à l’égard de l’ANE. Mais ce passage du discours trahit surtout une certaine nervosité institutionnelle, voire une tentative de disqualification des critiques légitimes : « L’ANE est une institution indépendante chargée de toutes les opérations électorales et référendaires », affirme le président.
Pourtant, les faits récents contredisent cette affirmation d’indépendance. L’ANE a organisé seule le référendum du 30 juillet 2023, financé exclusivement par le gouvernement. Ce référendum a abouti à une nouvelle Constitution, contestée par une partie de la classe politique et adoptée dans un climat d’opacité et de désinformation.
Le taux de participation avancé de 61,10 % n’a jamais été validé par une observation indépendante crédible, alors que les grandes organisations internationales (UE, OIF, UA) étaient absentes du processus. En clair, l’ANE se présente comme indépendante tout en exécutant scrupuleusement une feuille de route politique dictée depuis le Palais de la Renaissance. Son autorité morale et juridique est donc affaiblie.
Un processus électoral à haut risque
Les élections groupées prévues pour le 28 décembre 2025 législatives, locales et présidentielle s’annoncent comme les plus sensibles de la décennie. Pourtant, l’ANE ne semble pas pleinement préparée à faire face aux défis suivants : La sécurité des opérations dans les zones à risque reste très incertaine, la crédibilité des listes dépendra du traitement rapide et impartial des réclamations, la confiance des citoyens est minée par un lourd passif institutionnel et l’absence de contre-pouvoirs visibles.
Enfin, la concentration de tous les scrutins sur une même date fait planer le risque d’un chaos organisationnel, d’autant plus que les capacités logistiques de l’ANE restent limitées, et que le financement international demeure incertain.
Entre autosatisfaction et vigilance démocratique
L’allocution du président de l’ANE tente de convaincre que tout va bien. Mais derrière les chiffres et les formules convenues, le processus électoral centrafricain reste fragile, exposé aux manipulations politiques, à la défiance populaire, et à l’insécurité persistante.
Ce n’est pas d’autosatisfaction dont le pays a besoin, mais de garanties concrètes : la présence d’observateurs nationaux et internationaux réellement indépendants, la transparence totale sur les listes électorales, l’équité dans l’accès aux médias et aux ressources pour tous les candidats, et une justice électorale impartiale.
Sans ces garde-fous, les élections du 28 décembre pourraient s’ajouter à la longue liste des scrutins contestés de l’histoire centrafricaine.