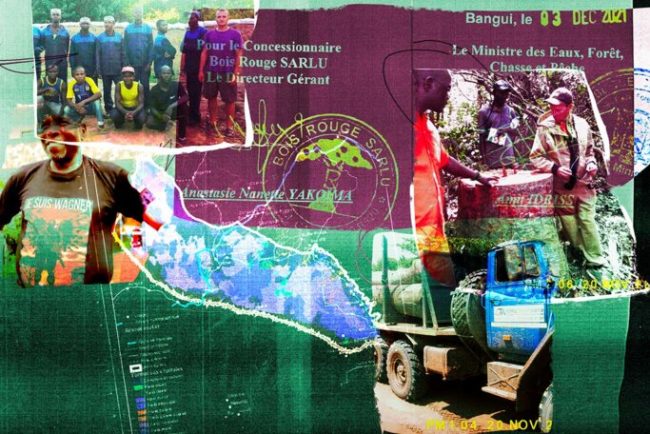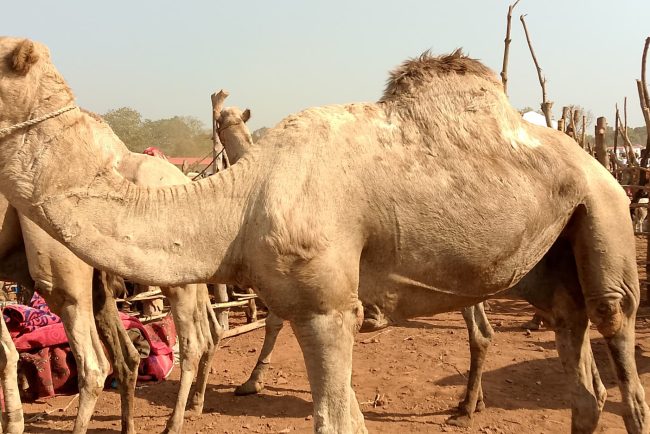La scène médiatique centrafricaine connaît depuis quelques jours une agitation inhabituelle. Le Haut Conseil de la Communication (HCC), organe constitutionnel de régulation, et l’un de ses membres, le conseiller Didier Martial Pabandji, s’affrontent dans un bras de fer institutionnel aux accents de rupture définitive. L’affaire, partie d’un simple avertissement disciplinaire, met aujourd’hui en lumière des tensions plus profondes sur l’équilibre entre devoir de réserve, liberté d’expression et crédibilité des institutions.
Le 12 août 2025, un communiqué officiel du HCC, signé par son président José Richard Pouambi, condamnait les prises de parole publiques de Didier Martial Pabandji. L’institution reproche au conseiller ses apparitions en direct sur les réseaux sociaux, ainsi que des publications jugées incompatibles avec son statut. Pour le régulateur, il s’agit d’une violation de la loi organique n° 24.004 du 20 mars 2024 relative à l’organisation et au fonctionnement du HCC, mais également de la loi n° 20.027 du 21 décembre 2020 sur la liberté de communication. Ces textes encadrent à la fois les obligations des membres du Conseil et les droits des citoyens en matière de communication publique.
En toile de fond, l’accusation est claire : Pabandji aurait manqué à son obligation de réserve et compromis la réputation du HCC. L’institution a voulu réaffirmer, à travers ce communiqué, son attachement à l’éthique, à la transparence et au professionnalisme, rappelant sa mission de gardien de l’équilibre médiatique et de la cohésion sociale.
Dix jours plus tard, le 22 août, le HCC passe à l’acte et inflige à Didier Martial Pabandji un avertissement disciplinaire. La décision est rapidement rendue publique, relayée abondamment sur les réseaux sociaux, ce qui contribue à accentuer la polémique.
Face à cette sanction, le conseiller réagit avec vigueur. Il dénonce une décision « illégale, injuste et attentatoire à sa réputation ». Selon lui, la procédure n’a respecté ni le règlement intérieur du HCC ni les garanties minimales prévues par les textes. L’absence d’audition préalable, l’absence de convocation et la participation de seulement cinq conseillers à la délibération constituent, à ses yeux, des irrégularités manifestes. Pabandji s’appuie notamment sur les articles 91 et 101 qui imposent la présence de tous les membres et l’audition du mis en cause avant toute sanction. À ce titre, il considère que la décision est « nulle de droit ».
Concernant les faits reprochés, Pabandji assume avoir publié des messages sur Facebook les 9, 16 et 20 août. Toutefois, il les qualifie d’exercice légitime de sa liberté d’expression, visant essentiellement à défendre son honneur face à ce qu’il décrit comme des attaques diffamatoires. Il cite nommément certains de ses détracteurs, dont M. Édouard Yamalet et Mme Koulaninga, qu’il accuse d’avoir porté atteinte à son image. Pour lui, ces publications n’ont révélé aucun secret de délibération ni porté préjudice au HCC.
Mais l’affaire dépasse la simple querelle disciplinaire. Elle prend une dimension politique lorsque Pabandji accuse ses adversaires de chercher à l’instrumentaliser pour nuire indirectement au président Faustin-Archange Touadéra. Selon lui, certains voudraient associer le chef de l’État à des procédures internationales sensibles, notamment devant la Cour pénale internationale, et utilisent ce prétexte pour l’affaiblir par ricochet. En s’attaquant à lui, ils viseraient en réalité plus haut.
L’argument est lourd de sens dans un pays où les équilibres politiques et institutionnels restent fragiles. Le HCC, en tant qu’organe de régulation, est censé garantir un espace médiatique équilibré, loin des luttes partisanes. Or, en sanctionnant l’un de ses propres membres, et en exposant publiquement cette décision, l’institution s’expose elle-même à des accusations de partialité. La crédibilité du Conseil se retrouve ainsi fragilisée, au moment même où il cherche à la renforcer.
La riposte de Pabandji s’organise désormais sur le terrain judiciaire. Avec l’appui de son conseil, il a saisi le Tribunal administratif de Bangui pour demander l’annulation pure et simple de la sanction. Il se présente comme défenseur de la transparence, de l’éthique et de la liberté de communication, insistant sur sa loyauté républicaine et sa volonté de protéger la vérité. Ce recours pourrait marquer une étape décisive : si la justice venait à invalider la décision du HCC, l’institution se trouverait considérablement affaiblie, exposée au soupçon d’avoir agi hors du cadre légal.
Cet épisode révèle en filigrane une question de fond : jusqu’où un organe de régulation peut-il limiter la liberté de ses propres membres au nom du devoir de réserve ? Et à partir de quel moment cette restriction se transforme-t-elle en atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ? La frontière est ténue, et l’affaire Pabandji en est l’illustration parfaite.