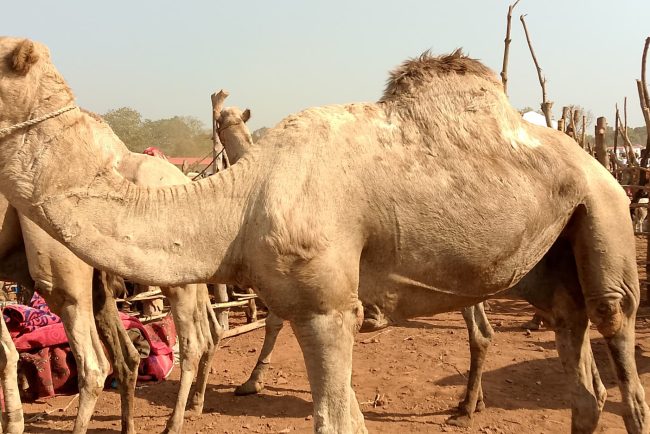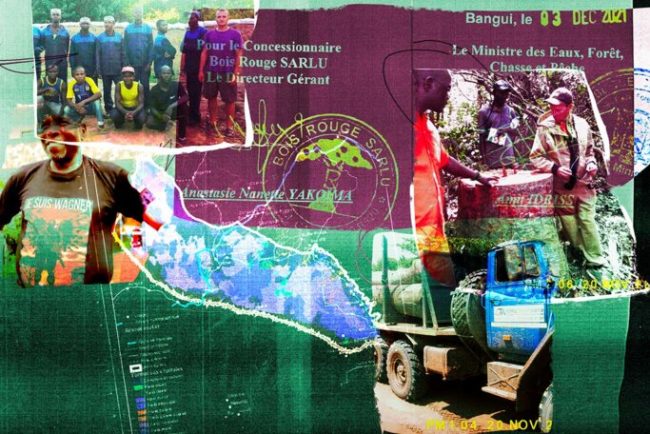À l’approche des élections de 2025, la République centrafricaine se retrouve face à une question importante : comment préserver un espace politique pluraliste alors que s’accumulent les signaux d’une fermeture du régime ? Depuis l’indépendance, l’histoire politique centrafricaine oscille entre expériences éphémères de multipartisme et retour régulier à la personnalisation du pouvoir. L’enjeu n’est plus seulement de savoir qui remportera le prochain scrutin, mais dans quel type de régime vivront les Centrafricains après.
Depuis 1960, la trajectoire du pays est marquée par une succession de régimes personnalisés. David Dacko incarne d’abord l’État-indépendance, avant d’être supplanté par Jean-Bédel Bokassa, qui pousse à son paroxysme la logique d’« État-personne », jusqu’à proclamer un Empire en 1976. André Kolingba impose ensuite un parti-État (RDC) de 1981 à 1993, avant d’accepter, sous contrainte, l’ouverture au multipartisme.
La première alternance démocratique survient avec Ange-Félix Patassé en 1993, mais les mutineries et l’insécurité permanente fragilisent la jeune démocratie. François Bozizé reprend le pouvoir par les armes en 2003, avant d’organiser des élections contestées et de resserrer son emprise. L’effondrement sécuritaire de 2013 amène la coalition Séléka au pouvoir, puis une transition chaotique confiée à Catherine Samba-Panza.
En 2016, Faustin-Archange Touadéra accède à la présidence par les urnes, nourrissant l’espoir d’un renouveau pluraliste. Mais la révision constitutionnelle de 2023, supprimant la limite de mandats, puis sa candidature déclarée pour un troisième mandat en juillet 2025, ravivent les inquiétudes.
L’histoire centrafricaine enseigne un constat clair : chaque fois que la compétition politique se réduit autour d’un seul homme ou d’un parti dominant, les libertés reculent et les crises s’aggravent. À l’inverse, les fenêtres de pluralisme, en 1993 comme en 2016, n’ont jamais survécu bien longtemps aux secousses sécuritaires et aux fragilités institutionnelles.
Voyants à l’orange : démocratie ou autoritarisme « soft »
La démocratie repose sur quelques piliers bien identifiés : possibilité d’alternance, protection de l’opposition, justice indépendante, médias libres et élections crédibles. À l’opposé, l’autoritarisme dans sa version dure ou « adoucie » assimile l’opposant à un ennemi, instrumentalise la justice, verrouille la presse et modifie les lois pour assurer la succession.
En Centrafrique, les signaux sont préoccupants. Les élections locales sont régulièrement reportées, l’Autorité nationale des élections (ANE) est contestée, les partis d’opposition multiplient les boycotts et la Constitution de 2023 a consolidé un déséquilibre de pouvoir au profit de l’exécutif. Le pluralisme existe encore sur le papier, mais ses fondements pratiques s’érodent.
Dans l’idéal, un multipartisme authentique garantit aux partis un accès équitable aux médias et à un financement transparent, encadré par une administration électorale neutre. En pratique, la Centrafrique se rapproche d’un système où un parti dominant neutralise ses adversaires, contrôle les ressources coercitives et instrumentalise la justice.
Le pays affiche ainsi une vitrine démocratique existence légale de multiples partis tout en évoluant vers une hégémonie de fait. La suppression de la limite présidentielle, la dépendance à des acteurs sécuritaires extérieurs et le climat d’intimidation en période préélectorale accentuent cette ambiguïté.
Sécurité, influence extérieure et politique : un triangle piégé
L’un des nœuds majeurs réside dans la sécurité. La persistance d’attaques armées par divers groupes dont les 3R maintient une insécurité chronique. Le recours à des sociétés militaires étrangères, au cœur de controverses, alimente un climat où toute critique de la ligne gouvernementale peut être assimilée à une menace contre la stabilité. La politique se « sécuritarise », et l’opposant devient aisément un suspect.
À quelques mois du scrutin présidentiel, deux scénarios se dessinent
Scénario A : Pluralisme consolidé : réforme en profondeur de l’ANE, garanties offertes à l’opposition, observation électorale robuste. Un scrutin compétitif renforce la légitimité du vainqueur et peut ouvrir la voie à une désescalade sécuritaire.
Scénario B : Hégémonie verrouillée : institutions captées, justice instrumentalisée, sécuritaire dominant. Une victoire acquise dans un climat verrouillé offrirait au pouvoir une légitimité courte mais ouvrirait une longue période d’instabilité, faite de contestations, d’isolement diplomatique et d’économie de prédation.
Or, les retards déjà constatés et les boycotts en cours indiquent que le temps joue contre la crédibilité du processus si aucune inflexion n’intervient.
Pourquoi l’opposition n’est pas l’ennemie
Assimiler l’opposition à l’ennemi de la République revient à fragiliser l’État. On se prive d’un système d’alerte précoce contre la prédation, on étouffe l’innovation politique et, à terme, on prépare le terrain à la violence. L’opposition n’est pas une menace mais une ceinture de sécurité : elle garantit au pouvoir en place la possibilité d’une alternance pacifique et prévisible.
La réforme constitutionnelle de 2023, la candidature au troisième mandat en 2025 et la série de reports électoraux posent une question fondamentale : la République centrafricaine veut-elle s’inscrire dans une logique d’hégémonie durable, ou bien préserver un pluralisme fragile mais vital ?
Au fond, l’élection de 2025 n’est pas seulement un affrontement entre candidats. C’est une interrogation existentielle sur le régime lui-même. S’agira-t-il d’une étape de consolidation du pluralisme ou d’un basculement assumé vers l’hégémonie ? Dans un contexte où les institutions sont fragiles, où la sécurité reste externalisée et où l’opposition est fragilisée, le choix qui se joue dépasse le vainqueur du scrutin.
Sans opposition respectée, la démocratie s’éteint à ciel ouvert. L’histoire politique centrafricaine, marquée par des décennies de personnalisation et de crises, invite à ne pas répéter les erreurs passées. Préserver le pluralisme, c’est choisir la stabilité durable contre l’instabilité chronique.