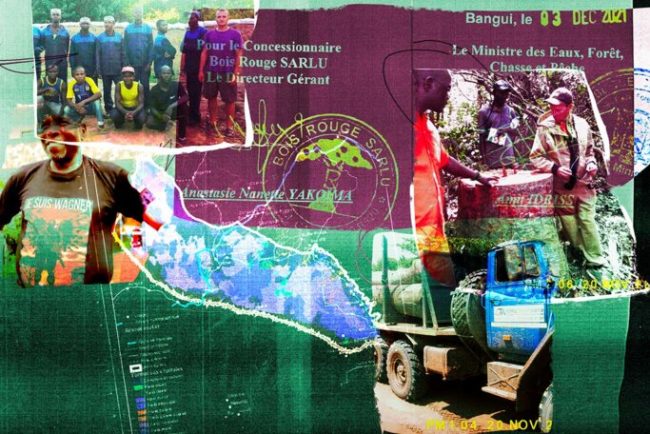La République centrafricaine est malade. Son mal est ancien, profond, et systémique. Il ne se résume ni à une série de crises militaires ni à quelques instabilités politiques. Il s’agit d’un effondrement moral, institutionnel et générationnel. Tant que le pays se contentera de pansements diplomatiques, de dialogues de façade et d’amnisties déguisées, la paix durable restera un mirage.
Un État gangrené par le « boubouritisme » et l’impunité. Le « boubouritisme » ce désordre institutionnel devenu chronique s’est enraciné au sommet de l’État : nominations clientélistes, pouvoirs sans contrepoids, lois sur-mesure pour des clans, et violations permanentes des principes constitutionnels.
Article 1er de la Constitution centrafricaine (2023) : « La République centrafricaine est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle fonde son autorité sur la souveraineté populaire et le respect de l’État de droit. »
En pratique ? La souveraineté est confisquée, le droit est piétiné, et la démocratie est un slogan creux. Pire : l’histoire du pays est écrite au cutter, avec des élites politiques, religieuses et militaires responsables à 90 % des crises récentes, soit par les actes physiques (crimes, pillages, incendies de lieux sacrés), soit par des incitations à la haine sur les ondes et les réseaux sociaux.
Article 5 du Code pénal centrafricain : « Est puni comme auteur quiconque provoque directement à la commission d’un crime ou d’un délit, même si la provocation n’est pas suivie d’effet. » Aucun leader communautaire ou politique n’a encore répondu de ses appels au lynchage ou à la division ethnique.
Une justice sélective et silencieuse
La justice centrafricaine est muette face aux puissants. Depuis le rapport de la Commission d’enquête internationale des Nations Unies (2015), qui documentait des crimes contre l’humanité de toutes les parties, aucun véritable procès d’envergure n’a été mené sur le territoire national. La Cour pénale spéciale (CPS), bien que prometteuse, reste paralysée par les pressions politiques et le manque de moyens.
Préambule de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA, 2019) : « Les parties s’engagent à lutter contre l’impunité, tout en promouvant la réconciliation nationale. ». En réalité, des seigneurs de guerre siègent au gouvernement ou sont recyclés dans l’administration.
Face à l’impasse, la seule voie viable est une refondation morale et institutionnelle, portée par une génération consciente, lucide sur les fautes passées et déterminée à bâtir un avenir commun. Elle repose sur quatre piliers :
1. Une justice transitionnelle enracinée : Création de tribunaux hybrides (nationaux et internationaux) pour juger les crimes les plus graves. Mise en place de commissions locales de vérité dans chaque préfecture, où les coupables peuvent demander pardon en échange de réparations ou de restrictions civiles. Inspiré des modèles rwandais (Gacaca) et sud-africain (Commission Vérité et Réconciliation).
2. Un désarmement mental massif : Lancer une éducation civique obligatoire dans toutes les écoles, les églises et les radios, avec des programmes de lutte contre le tribalisme, la haine religieuse et le sexisme. Aligné avec l’article 23 de la Constitution sur l’accès égal à l’éducation et à l’information patriotique.
3. Une inclusion générationnelle obligatoire : Instauration de quotas jeunes et femmes dans les institutions (25 % minimum), accompagnés par des experts de la diaspora. Formation de 10 000 jeunes « ambassadeurs de paix » en médiation communautaire. Conformément à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine : « La jeunesse comme moteur du changement ».
4. Une économie réparatrice et contrôlée : Mise en place d’un Fonds de reconstruction nationale, financé par les recettes minières, géré de manière transparente sous contrôle citoyen.
Objectif : reconstruire les écoles, routes, centres de santé, tout en réduisant les inégalités régionales.
Article 64 de la Constitution : « Les ressources naturelles appartiennent au peuple ». Le vrai patriotisme commence par la lucidité. « Nul n’est juridiquement innocent » : cette phrase dérange, mais elle libère. Elle oblige chacun leaders, intellectuels, militaires, journalistes, religieux à se regarder dans le miroir de l’histoire.
Le pardon collectif n’est pas l’oubli : c’est la reconnaissance des fautes et le choix conscient du vivre-ensemble. Il est temps de faire un pacte de vérité et de courage, où la richesse collective primera sur les intérêts claniques, où la jeunesse ne sera plus instrumentalisée mais responsabilisée, et où la justice ne sera plus un luxe, mais une base non négociable de la paix.