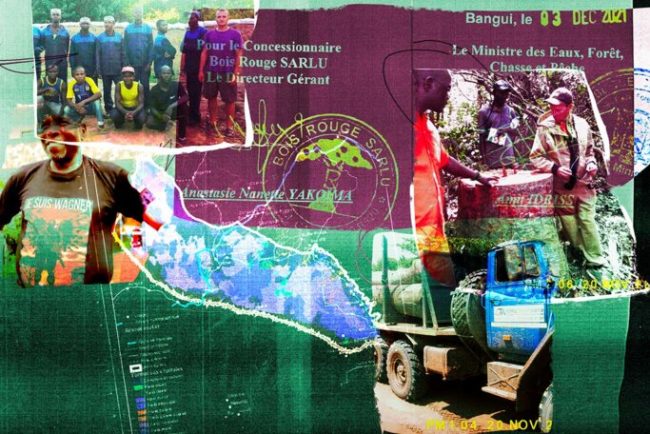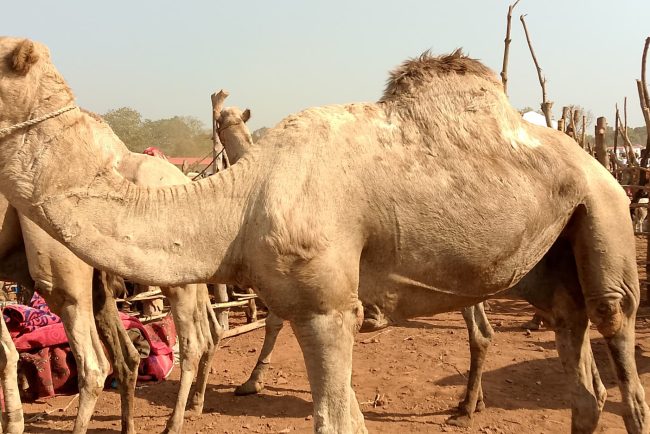Yaoundé, le 30 Septembre 2025, À l’approche de la prochaine élection présidentielle, la question du financement des campagnes électorales refait surface avec acuité au Cameroun. Selon la loi, les partis politiques ont droit à des financements publics pour leurs activités, y compris les campagnes. Mais dans les coulisses du pouvoir, cet argent public soulève des questions sur l’équité du jeu démocratique et l’indépendance des formations politiques.
Un financement public inégalitaire
Au Cameroun, le financement public des partis politiques est régi par la loi de 2019. Il existe deux types de financement : le financement permanent pour le fonctionnement des partis et le financement spécial pour les campagnes électorales. Selon les chiffres officiels, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), au pouvoir depuis 1985, reçoit la part du lion de ces financements.
« Le système est structurellement déséquilibré », analyse un politiste de l’Université de Yaoundé qui requiert l’anonymat. « Le parti au pouvoir bénéficie non seulement des fonds publics alloués légalement, mais aussi de tous les moyens de l’État – transports, logistiques, médias publics – qui sont mis à sa disposition pendant les campagnes. »
L’opposition entre survie financière et indépendance politique
Pour les partis d’opposition, la perception de ces fonds publics crée un dilemme existentiel. D’un côté, ces ressources sont vitales pour mener une campagne crédible. De l’autre, certains dénoncent un système qui maintiendrait l’opposition sous perfusion financière du pouvoir.
« Cet argent est un piège », estime un leader d’un parti d’opposition qui préfère garder l’anonymat. « D’abord, les montants sont dérisoires comparés à ce que reçoit le RDPC. Ensuite, les retards dans le déblocage des fonds sont fréquents pour l’opposition, ce qui nous handicape dans notre préparation. »
Des conditions opaques
Plusieurs acteurs politiques évoquent des conditions non écrites qui accompagneraient l’obtention de ces financements. « Il y a une compréhension tacite que cet argent doit servir à une ‘opposition constructive’, ce qui signifie en réalité une opposition qui ne dérange pas trop », affirme un ancien député.
La position du gouvernement
Contacté sur cette question, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, réaffirme l’engagement de l’État à « garantir des élections transparentes et équitables ». Il souligne que « le financement des partis politiques se fait conformément à la loi et sous le contrôle de la justice ».
Pourtant, sur le terrain, les disparités sautent aux yeux. Pendant que les meetings du RDPC bénéficient d’une logistique impressionnante – scènes géantes, sonorisation professionnelle, transports des militants – les partis d’opposition doivent souvent composer avec des moyens limités.
Une démocratie en sursis
Ce système de financement interroge la qualité de notre démocratie. « Quand le jeu n’est pas équitable dès le départ, comment peut-on parler d’élections libres et crédibles ? », s’interroge une responsable d’organisation de la société civile.
Alors que la campagne approche, nombreux sont ceux qui appellent à une réforme en profondeur du système. « Il faut plus de transparence dans l’attribution des fonds, un calendrier de déblocage respecté pour tous, et un contrôle indépendant », plaide un juriste spécialiste du droit électoral.
En attendant, l’argent public continue de couler vers les partis politiques, alimentant une machine électorale où les dés semblent pipés d’avance. La véritable question est de savoir si cet argent sert à démocratiser la compétition politique ou simplement à perpétuer un système déséquilibré qui mine la crédibilité du processus démocratique camerounais.