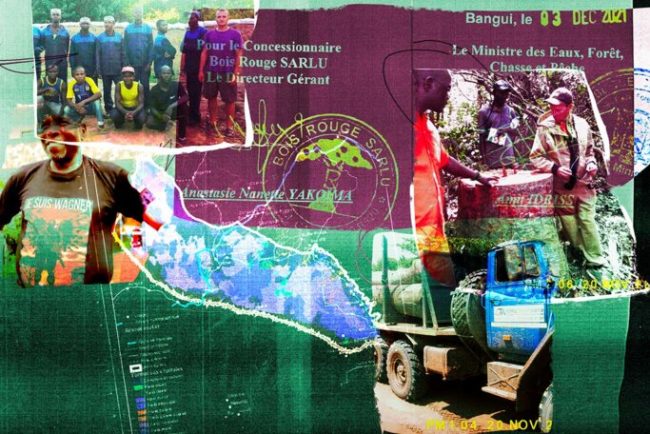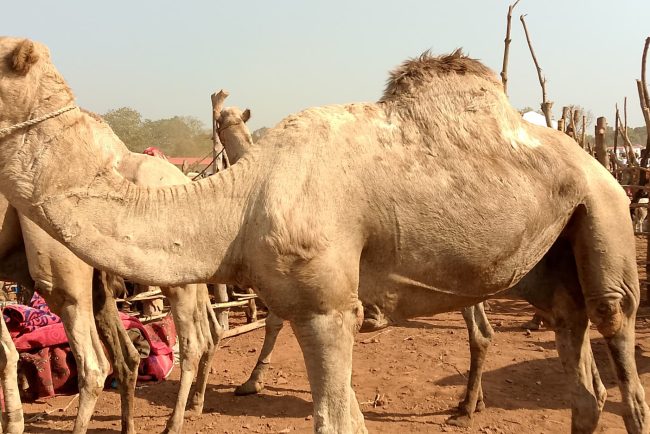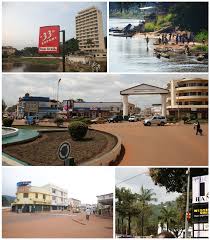
Bangui, capitale de la République centrafricaine, fait face depuis des décennies à des défis majeurs en matière d’urbanisation. Entre absence de planification, infrastructures défaillantes et manque de services essentiels, la ville peine à répondre aux besoins croissants de sa population.
Jusqu’à la fin des années 1980, Bangui présentait une urbanisation partielle, principalement concentrée dans son centre-ville. En périphérie, de vastes quartiers comme Boy-Rabe, Miskine, Malimaka, Galabadja ou Moustapha restaient mal aménagés, avec des voies principales mais sans réseau structurant. L’absence de voiries et réseaux divers (VRD) eau, électricité, téléphone, égouts a empêché ces quartiers de se développer correctement. Sans ces infrastructures de base, l’accès aux services publics est limité, et le coût de construction pour les habitants reste élevé.
« Les risques liés au manque d’aménagement »
Cette situation engendre des risques considérables. L’un des plus préoccupants est l’insécurité, aggravée par l’absence d’éclairage public. Une ville mal éclairée devient un terrain propice aux agressions et aux braquages. Le manque de voies d’accès complique également le travail des sapeurs-pompiers, qui se retrouvent dans l’incapacité d’intervenir rapidement en cas d’incendie ou d’urgence.
Dans les années 1980, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) portait l’ambition d’une « santé pour tous en l’an 2000 ». Mais en l’absence d’un environnement sain, cet objectif est resté hors de portée.
L’accumulation des déchets et des eaux stagnantes favorise la prolifération des agents pathogènes et de maladies telles que la méningite, la grippe, les infections intestinales et le paludisme. Une ville mal assainie devient un foyer permanent de contamination, affaiblissant la population et pesant sur les finances des ménages, contraints de consacrer une part importante de leur budget aux soins médicaux.
L’hygiène publique est un élément fondamental du bien-être urbain. Tout comme les hôpitaux ont dû être assainis pour éviter les infections nosocomiales, une ville doit être entretenue pour protéger ses habitants.
« L’impact psychologique de l’environnement urbain »
L’aménagement d’une ville ne concerne pas uniquement ses infrastructures physiques. Il joue aussi un rôle déterminant sur le bien-être psychologique et social de ses habitants.
Un environnement structuré et esthétique stimule la créativité et favorise l’émergence de métiers artistiques comme la peinture et la danse. À l’inverse, un cadre désordonné et délabré peut limiter l’inspiration et nuire au dynamisme culturel et social.
Ce que l’on considère souvent comme des déchets peut en réalité être une ressource. La gestion efficace des ordures urbaines pourrait non seulement réduire la pollution, mais aussi créer des opportunités économiques.
Autrefois, la combustion des déchets produisait de l’énergie réutilisable. Cependant, cette méthode libère des substances toxiques comme la dioxine, qui contamine le lait et la viande des animaux domestiques et augmente le risque de cancer. Aujourd’hui, des solutions plus durables existent, notamment : Le compostage, qui permet de produire des engrais organiques pour l’agriculture, le recyclage des plastiques, qui peut servir à fabriquer des pavés pour les espaces publics, la valorisation des métaux, qui peuvent être refondus et réutilisés.
Les pays industrialisés ont compris l’importance de ces pratiques. Bangui pourrait s’en inspirer pour améliorer son cadre de vie et réduire l’impact environnemental de ses déchets.
« Quelle vision pour l’avenir de Bangui ? »
Les défis urbains auxquels fait face Bangui ne sont pas insurmontables. Comme le soulignait déjà l’architecte Philippe Makoundji en 1993 : « À tout problème, il existe une solution. Mais pour cela, il faut une volonté déterminée de changer les choses. Sans une véritable ambition de transformation, rien ne pourra être accompli, même avec tous les moyens nécessaires. »
Réfléchir collectivement à l’avenir de Bangui et agir concrètement sont des impératifs. Sauver la capitale, c’est aussi assurer son rôle de vitrine nationale et internationale, en en faisant un modèle d’urbanisation maîtrisée et durable.