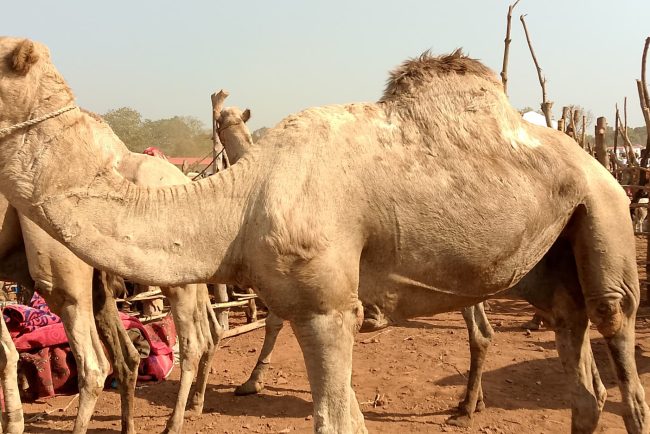La démission de Vital Kamerhe de la présidence de l’Assemblée nationale, survenue le 22 septembre 2025, secoue une nouvelle fois l’édifice politique congolais. Entre contestations internes, pétition controversée et calculs stratégiques, ce départ inattendu révèle à la fois la fragilité des institutions et la place singulière occupée par Kamerhe dans le jeu politique.
Son geste, loin d’être anodin, cristallise les tensions entre ambitions personnelles et exigences de stabilité dans un pays encore marqué par de profondes incertitudes.
Vital Kamerhe était visé depuis plusieurs semaines par une pétition initiée par des députés de la majorité et de l’opposition. Les griefs avancés concernaient sa gestion jugée opaque des finances de l’Assemblée, des décisions prises sans concertation et un style jugé trop autoritaire. La commission spéciale chargée de l’examiner avait validé le texte sur la forme, malgré des contestations portant sur des signatures litigieuses, des doublons et des noms supposément falsifiés.
Plutôt que d’affronter une plénière décisive dont l’issue lui semblait défavorable, Kamerhe a choisi de prendre de vitesse ses adversaires en annonçant sa démission lors de la conférence des présidents des groupes parlementaires. Une manière d’éviter l’humiliation d’un vote et de contrôler, au moins en partie, sa sortie. Dans son discours, il a invoqué « l’amour de la patrie » et refusé toute rancœur, appelant les élus à se concentrer sur « les vrais défis du peuple ».
Félix Tshisekedi entre neutralité affichée et proximité personnelle
Le président Félix Tshisekedi, lui aussi surpris par l’annonce, a tenu à se démarquer de toute responsabilité : « J’ai appris comme vous la démission de Vital Kamerhe », a-t-il déclaré, soulignant que cette affaire relevait de la « cuisine interne » de l’Assemblée nationale.
En tant que garant des institutions, Tshisekedi dit avoir souhaité que la rentrée parlementaire se déroule dans le calme et la sérénité, mais il se refuse à interférer dans le fonctionnement autonome de la chambre basse. Toutefois, le chef de l’État a tenu à préserver sa relation avec l’ancien président de l’Assemblée : « Je continue de considérer Vital Kamerhe comme un allié, comme un frère, à moins qu’il n’en décide autrement. » Ce double langage neutralité institutionnelle d’un côté, loyauté personnelle de l’autre illustre à quel point l’équilibre entre les ambitions individuelles et les impératifs de stabilité demeure délicat dans la gouvernance congolaise.
Si la pétition contre Kamerhe met en avant des griefs précis, leur portée réelle demeure discutée. Certains observateurs y voient surtout un règlement de comptes politique : dans une majorité où l’alignement sur la ligne présidentielle est scruté à la loupe, toute nuance est perçue comme une dissidence.
Kamerhe, malgré son rôle clé dans l’accession de Tshisekedi au pouvoir en 2019, était parfois accusé de cultiver trop d’indépendance.
Un coup dur pour l’UNC et une opportunité pour la majorité
La démission de Kamerhe fragilise son parti, l’Union pour la Nation Congolaise (UNC), déjà secoué par des dissensions internes. En perdant la présidence de l’Assemblée, l’UNC se prive d’une plateforme institutionnelle majeure qui lui permettait d’exister face à l’hégémonie de l’UDPS et de ses alliés. Cette perte affaiblit son influence et risque de marginaliser davantage ses cadres dans les négociations politiques à venir.
À l’inverse, la majorité présidentielle y voit une opportunité de renforcer son contrôle. L’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale et d’un rapporteur offre au camp présidentiel la possibilité de consolider son emprise sur une institution stratégique. La recomposition qui s’annonce sera un moment clé : permettra-t-elle d’élargir la coalition ou accentuera-t-elle au contraire la logique de centrali-sation autour du parti présidentiel ?
À 66 ans, Vital Kamerhe n’en est pas à sa première épreuve politique. Ancien président de l’Assemblée, ancien directeur de cabinet de Tshisekedi et ex-candidat à la présidentielle, il a toujours su rebondir malgré les revers. Sa démission actuelle peut être interprétée comme un recul tactique, destiné à préserver son image et à préparer un retour. En se présentant comme un homme de paix, refusant la confrontation, il cherche peut-être à se repositionner comme figure d’équilibre dans un paysage politique fracturé.
Un révélateur de la fragilité institutionnelle
Au-delà de l’homme et de son parti, cet épisode met en lumière la vulnérabilité des institutions congolaises. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires à l’Est, les attentes sociales pressantes et les urgences économiques, la vie parlementaire semble dominée par des luttes internes plus que par la recherche de solutions concrètes.
La démission de Kamerhe rappelle que la stabilité institutionnelle, tant recherchée par Tshisekedi, repose encore sur des équilibres précaires, sensibles aux rivalités personnelles et aux ambitions partisanes. Dans une République démocratique du Congo où chaque crise parlementaire peut avoir des répercussions nationales, cet événement souligne à quel point la consolidation démocratique reste un chantier inachevé.