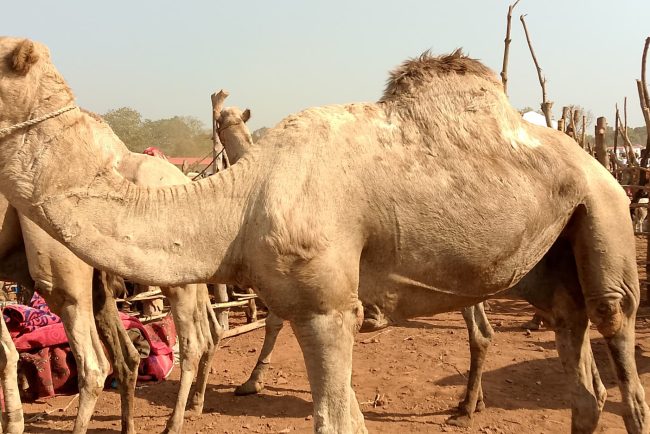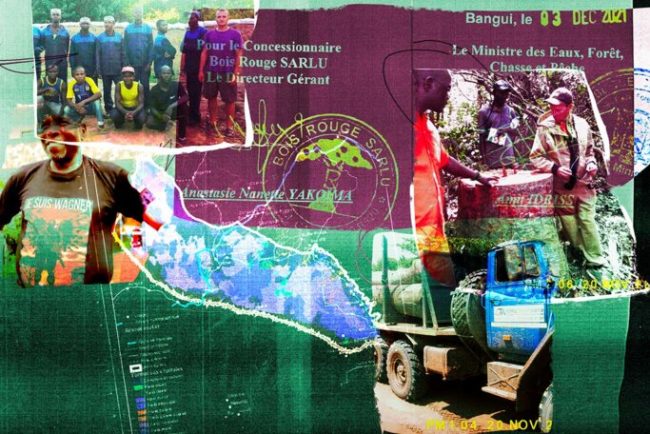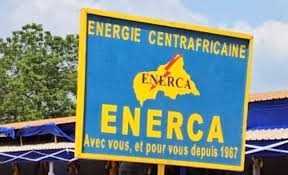
Depuis plusieurs semaines, la capitale centrafricaine est plongée dans l’obscurité. Officiellement, l’ENERCA évoque une panne technique à la sous-station B de Gobongo. Officieusement, l’incompréhension et la colère montent face à des explications jugées incohérentes.
Comment un incident isolé peut-il provoquer une coupure généralisée ? Pourquoi le gouvernement semble-t-il naviguer à vue dans la gestion de cette crise ? Et surtout, à neuf mois des élections présidentielles, ce blackout est-il vraiment accidentel ?
Ce nouvel épisode d’instabilité énergétique ne fait que révéler les fragilités d’un État où la communication officielle oscille entre amateurisme et dissimulation. Entre sabotage politique, incompétence technique et mensonge d’État, le doute s’installe.
Dans son communiqué, l’ENERCA a adopté un ton laconique : une panne, des équipes mobilisées, un retour à la normale promis. Pourtant, cette version peine à convaincre, tant elle occulte des questions fondamentales : « Pourquoi un simple incident à Gobongo provoque-t-il un blackout total ? Un réseau bien structuré devrait permettre une réaffectation de la charge, évitant ainsi une coupure généralisée. »
Pourquoi le gouvernement n’a-t-il jamais investi sérieusement dans la modernisation du réseau ? Depuis des années, les experts alertent sur l’obsolescence des infrastructures, mais les promesses de renforcement restent lettre morte.
« Pourquoi l’État minimise-t-il la crise alors qu’elle paralyse la capitale ? »
Cette coupure s’ajoute à une longue liste de défaillances énergétiques. Elle rappelle surtout que le pays, malgré les aides internationales et les partenariats annoncés, est incapable de garantir une fourniture électrique stable à sa population. Arthur Piri, ministre en charge de l’énergie, se trouve au centre de la tempête. Selon plusieurs sources, il aurait assuré au président que la situation était sous contrôle, avant que le blackout ne s’aggrave.
Faut-il y voir une gestion approximative ou un mensonge délibéré ? La question est lourde de conséquences. Si le ministre a minimisé la crise pour éviter de froisser le sommet de l’État, cela signifie que l’information qui parvient au président est biaisée. Dans un pays où l’énergie est un enjeu stratégique, un tel manque de transparence pose un sérieux problème de gouvernance.
Dans d’autres pays, un ministre mis en cause dans une crise nationale présenterait sa démission ou serait immédiatement limogé. En Centrafrique, la culture de l’impunité pourrait, une fois de plus, jouer en faveur du statu quo.
« Un Premier ministre invisible : stratégie ou mise à l’écart ? »
Autre fait troublant : le silence assourdissant du Premier ministre. Dans une telle crise, son rôle devrait être central, tant pour rassurer la population que pour piloter une réponse rapide. Or, il semble totalement effacé.
Ce vide politique alimente les spéculations. Est-il tenu à l’écart par le président Faustin-Archange Touadéra, soucieux de concentrer le pouvoir entre ses seules mains ? Ou a-t-il lui-même choisi de ne pas intervenir, conscient de son manque de marge de manœuvre ?
Dans tous les cas, ce silence conforte l’idée que le pouvoir fonctionne désormais en vase clos, avec un chef d’État préférant contourner son gouvernement plutôt que de lui confier la gestion des crises. Face à l’ampleur du blackout, certains observateurs avancent une hypothèse plus troublante : un sabotage organisé.
À quelques mois des élections présidentielles, ce type de crise profite forcément à certains acteurs politiques. Une coupure prolongée pourrait fragiliser le pouvoir en place, exacerber la grogne populaire et donner du grain à moudre à l’opposition.
Si l’idée d’un sabotage peut sembler complotiste, elle n’est pas à exclure dans un pays où les tensions politiques et économiques nourrissent les stratégies de déstabilisation. Une enquête indépendante permettrait d’en savoir plus, mais encore faudrait-il que les autorités acceptent d’ouvrir ce dossier en toute transparence.
« Un enjeu électoral majeur »
Ce blackout n’est pas un simple incident technique : il symbolise l’échec d’une gouvernance incapable d’anticiper et de résoudre les crises.
Trois scénarios sont envisageables : Un remaniement gouvernemental, avec des sanctions pour les responsables de cette gestion calamiteuse. Une enquête sérieuse pour établir si la coupure est accidentelle ou volontaire. Un plan d’urgence massif pour moderniser enfin le réseau électrique et éviter de nouveaux blackouts. Mais dans un pays où l’immobilisme politique est une règle tacite, il n’est pas certain que l’une de ces mesures soit adoptée.
Si cette panne perdure, elle risque d’alimenter un mécontentement déjà grandissant. Car au-delà du simple inconfort, l’absence d’électricité affecte les hôpitaux, les commerces, les écoles, et plonge des milliers de foyers dans une précarité accrue.
Et cette fois, aucun silence, aucune manœuvre politique ne pourra masquer la réalité : un État incapable d’assurer un service aussi fondamental que l’électricité finira tôt ou tard par en payer le prix, dans les urnes ou dans la rue.