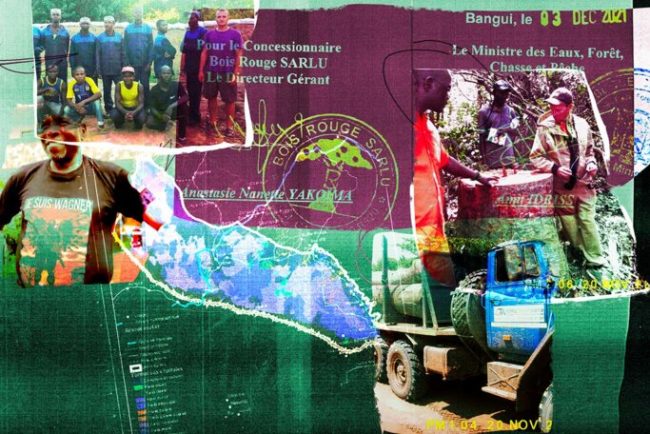Lorsqu’en 2016, Faustin-Archange Touadéra accède au pouvoir, nombreux sont les Centrafricains qui voient en lui un Moïse, capable de les sortir du chaos et de les mener vers la terre promise d’un pays pacifié et prospère. Après des années de guerre civile sous le règne de la Séléka de Michel Djotodia et une transition incertaine sous Catherine Samba-Panza, la République centrafricaine (RCA) semblait entrevoir une lueur d’espoir avec le retour à l’ordre constitutionnel.
Mais près de dix ans plus tard, cet espoir s’est effondré sous le poids d’une réalité bien plus dure que les promesses électorales. La RCA demeure engluée dans des problèmes structurels profonds, et le régime de Touadéra peine à répondre aux attentes d’un peuple lassé des discours sans lendemain.
Bangui, la capitale, offre un spectacle de désillusion. Les rues poussiéreuses, les coupures d’eau et d’électricité fréquentes, l’absence d’infrastructures dignes de ce nom est autant de signes du sous-développement persistant. Dans les provinces, la situation est encore plus dramatique : routes impraticables, services de base inexistants, et une éducation laissée à l’abandon, où des maîtres-parents tentent de combler tant bien que mal l’absence d’enseignants qualifiés.
Dans un pays où la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, la jeunesse subit de plein fouet l’incapacité de l’État à créer des emplois viables. Travailler, pour les plus chanceux, signifie tout juste survivre, payer quelques factures et espérer tenir jusqu’au mois suivant. Pour d’autres, cela implique d’accepter des « sales boulots », synonymes d’exploitation et d’absence de perspectives. Pourtant, paradoxalement, une partie de cette jeunesse, loin de s’insurger contre cette réalité, se laisse enrôler dans les démonstrations de soutien au régime, souvent contre quelques billets et promesses illusoires.
Sur le plan sécuritaire, les défis restent immenses. Des pans entiers du territoire échappent encore au contrôle de l’État, livrés aux groupes armés qui imposent leur loi et terrorisent les populations locales. Des localités comme Mingala, Pombolo ou Zangba sont des exemples criants de cette insécurité persistante. Pendant ce temps, les Forces Armées Centrafricaines (FACA), censées être la colonne vertébrale de la stabilité nationale, peinent à remplir leur mission, faute de moyens et de soutien.
Certains soldats déployés sur le terrain attendent désespérément leur Prime Globale d’Alimentation (PGA), tandis que d’autres, envoyés en mission depuis plus de dix mois, ne sont toujours pas relevés, comme à Nzako. Comment peut-on espérer restaurer l’autorité de l’État lorsque ceux qui en sont les garants se retrouvent eux-mêmes abandonnés par le pouvoir qu’ils servent ?
« Les promesses non tenues du développement »
En 2020, à l’approche des élections groupées, le régime de Touadéra avait multiplié les engagements, notamment dans le domaine de l’éducation et des infrastructures. On annonçait la construction d’universités en province, à commencer par Bangui, où une première pierre avait été posée à Sakaï. Quatre ans plus tard, cette pierre semble être devenue un monument à l’inaction gouvernementale.
Les routes, censées être réhabilitées pour assurer la libre circulation des biens et des personnes, restent dans un état déplorable. Il suffit de parcourir les axes Bangui-Mbaïki-Boda-Carnot-Berbérati ou Bangui-Bambari-Alindao-Bangassou-Rafaï-Zémio-Obo pour constater l’ampleur du problème. Loin d’être des artères du développement, ces routes sont devenues des pièges, où les voyageurs doivent braver insécurité et conditions impraticables.
À chaque échéance électorale, les mêmes stratégies sont réactivées : embauche de nouveaux fonctionnaires, promesses de projets pharaoniques, gesticulations politiques visant à donner l’illusion du progrès. Mais une fois les votes acquis, le souffle réformateur s’évapore, laissant place à la routine de l’inaction et de l’opacité.
Face à cette situation, les dirigeants centrafricains semblent évoluer dans une bulle déconnectée des souffrances quotidiennes du peuple. Loin de promouvoir des valeurs de transparence, de service et d’intégrité, ils s’enferment dans des logiques de clanisme, de népotisme et de clientélisme, où l’intérêt général est souvent sacrifié sur l’autel des calculs politiciens.
« L’honnêteté, la sincérité, la simplicité, l’humilité, la générosité, l’absence de vanité, la capacité à servir les autres sont les véritables fondations de notre vie spirituelle », disait Nelson Mandela. Ces principes, qui devraient guider toute gouvernance responsable, semblent aujourd’hui bien loin de la réalité centrafricaine.
En définitive, la RCA reste à la croisée des chemins. Le réveil de la jeunesse, l’éveil des consciences et la pression citoyenne seront-ils suffisants pour forcer un véritable changement ? Ou bien le pays continuera-t-il de s’enfoncer dans un cycle où chaque espoir né des urnes finit brisé par l’immobilisme et la mauvaise gouvernance ?
L’avenir de la Centrafrique dépendra de la réponse à cette question.